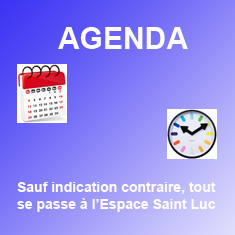
Agenda
Samedi 7 Juin 2025 à Saint-Luc
Messe de Pentecôte avec Homélie

La prière d’alliance, avec Ignace de Loyola:
« Merci, pardon, s’il te plaît »
Ignace, ses Exercices et le pape François lui-même jésuite nous invitent à récapituler chaque journée avec un
« examen de confiance-conscience »
dans lequel se déroulent trois des attitudes fondamentales de notre vie spirituelle :
la gratitude, « merci » pour les bienfaits discernés avec les lunettes des dons de l’Esprit Saint (le conseil) ;
la démarche de « pardon » pour les blessures infligées dans nos relations avec autrui, le cosmos, nous-mêmes et le Seigneur ; et les cris de supplication,
« s’il te plaît », quand la détresse se fait trop pesante.
« Merci » pour les merveilles dont notre ange gardien nous gratifie dans l’Esprit, lui qui éloigne les pierres de notre chemin (Psaume 90(91),11) ;
« pardon » pour la haine et la violence envers nos voisins, sur et autour d’un terrain de sport, par notre hyper consommation et notre exploitation indue de la planète qui brûle ; « s’il te plaît », Seigneur, accorde- nous la force, car sans toi nous ne pouvons rien faire (cf. Jean 15,5), donne nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin pour demain (cf. Matthieu 6,11),
aide-nous à faire, à dire et à manger moins,
car moins c’est plus et mieux.
Homélie du 7ème dimanche de Pâques
Dans ce texte, Saint-Jean nous fait entrer dans la prière de Jésus : « Jésus priait ainsi… » Cette prière de Jésus se situe juste avant sa Passion et sa mort. Il s’agit ainsi d’un moment important où Jésus, dans la prière, va faire monter vers son Père ses principales préoccupations. J’en note tout particulièrement trois, qui d’une manière ou d’une autre, se rejoignent.
D’abord il souligne pour qui s’adresse cette prière. Lorsque nous prions, nous nommons des personnes, tout à l’heure nous en évoquerons certaines au moment de la prière universelle. Et Jésus procède de la même manière, encore que c’est peut-être nous qui procédons comme lui ! Je note qu’il ne prie pas en faveur de ceux qui sont là, présents, autour de lui, donc qu’il ne prie pas pour ses amis immédiats. Il prie, au moins dans cet épisode pour qui, grâce au témoignage de ses amis, croiront en lui, en ces jours-ci et dans l’avenir. Au moment de mourir, Jésus porte déjà dans la prière, la vie de ceux qui deviendront ses témoins tout au long de l’histoire, grâce au témoignage de ses amis. Nous touchons ici un point fort de notre espérance : Jésus porte notre vie devant le Père afin qu’il nous rendre fort dans notre témoignage. Nous sommes tous présents dans la prière de Jésus, il ne nous abandonne pas.
Dans un deuxième temps, dans le verset suivant, Jésus demande quelque chose pour nous à son Père. Et que demande-t-il ? Il demande pour nous le don de l’unité. La question de l’unité se posait déjà dès le temps de Jésus. Ne croyons pas que la question de l’unité soit apparue avec la rupture de l’orthodoxie ou du protestantisme. Dès le point de départ, l’unité a été difficile à réaliser entre ceux qui provenaient du judaïsme (la religion de Jésus) et ceux qui étaient de culture grecque. Un apôtre comme Saint-Paul a beaucoup bataillé en faveur de l’unité.
Jésus prie pour l’unité mais la question est de comprendre ce qu’il dit de l’unité dans sa prière. Vous l’avez remarqué, Jésus ne prie pas pour que tous les chrétiens soient rassemblés dans une seule et même structure. Et par ailleurs, nous savons bien qu’une certaine multiplication des structures ne favorise pas non plus l’unité.
Alors que dit Jésus de cette unité ? Il commence à nous inviter à méditer l’unité qui règne entre lui et son Père. L’unité, c’est d’abord celle qui rassemble le Père et le Fils : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ». C’est l’union entre le Père et le Fils qui fonde l’unité des chrétiens.
Pour comprendre un peu mieux cette unité évoquée par Jésus dans sa prière, on a souvent utilisé dans l’histoire, l’image des rayons d’une roue et du moyeu. C’est en se rapprochant du centre que les rayons se rapprochent les uns des autres. Ce centre est le lieu où tous les rayons se réunissent et aussi le lieu d’où tous les rayons partent pour constituer la roue. L’unité chrétienne passe par notre proximité avec le Christ. Être proches du Christ ensemble et être proches du Christ aussi personnellement. Chaque jour nous faisons l’expérience que nous sommes écartelés entre la foi et la réalité de la vie, que nous sommes déchirés entre nos paroles et nos actions. Nous passons notre vie à rechercher de la cohérence dans notre manière de nous situer, à avancer dans une identité unifiée. Saint-Paul en est très conscient : « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » (Rm 7, 19). Se rapprocher du centre pour mettre de l’unité dans ma propre vie ; se rapprocher du centre pour mettre de l’unité dans la vie commune entre baptisés.
Le troisième point que je retiens est le motif que Jésus donne pour souligner l’importance de l’unité. Je cite : « Qu’ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé ». Il ne s’agit pas d’une unité pour manifester notre propre satisfaction. Cette unité a une dimension essentiellement missionnaire. L’unité est une des pratiques à réaliser pour rendre visible l’action de Dieu en faveur de toute l’humanité. Dans l’épître aux Éphésiens (2, 14) Saint-Paul écrit : « C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux peuples, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ». Le Christ a détruit le mur de la haine qui divise les hommes et peut les conduire jusqu’à leur destruction, comme nous le voyons chaque jour. Quand nous posons des gestes qui manifestent que le Christ a détruit ce mur de la haine entre les hommes, nous devenons témoins de ce Dieu qui invite à se rapprocher de lui pour construire avec lui une humanité réconciliée.
Cette prière de Jésus est à la fois un cri et une promesse qui courent à travers le temps et l’histoire de l’humanité. Un cri, un cri qui nous supplie de vivre en communion avec lui et avec nos frères, – et une promesse, une promesse car Jésus lui-même s’est donné jusqu’au bout pour nous rassembler, nous réunir afin de nous faire entrer dans l’intimité même de la vie de Dieu, afin de partager sa joie.
Dans notre prière rendons grâce pour ce cri et cette promesse et demandons qu’il envoie sur nous son Esprit-Saint afin d’entendre toujours ce cri et de poser des gestes qui concrétiseront cette promesse.
Robert Peloux